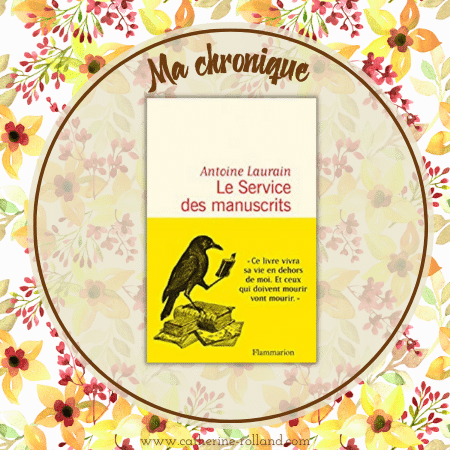Blackwater, de Michael McDowell
Il y a parfois des phénomènes littéraires inattendus, qui prennent tout le monde de court par l’ampleur de leur succès. C’est le cas de Blackwater, même si, à bien y réfléchir, quelques indices pouvaient permettre d’anticiper l’extraordinaire engouement dont cette saga fait l’objet.
Pour commencer, l’auteur est mort.
Et ça, d’un point de vue commercial, il faut reconnaître que c’est plutôt bon (il suffit de regarder du côté de la pauvre feue Lucinda Riley pour s’en persuader). La saga, écrite en 1982 par Michael McDowell (scénariste du film Beetlejuice, pour ceux qui s’en souviennent), n’avait jamais été traduite en France.
Avec un flair marketing que je leur envie sincèrement, les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont fondu sur cette histoire, ont imaginé pour chacun des 6 tomes un habillage or et argent d’une stupéfiante beauté et ont su créer l’envie, le besoin même, en publiant un tome tous les quinze jours à la façon d’un feuilleton. Ajoutons à cela un format poche entraînant un coût par tome franchement modeste (même en Suisse !).
Tous les ingrédients du succès étaient là. Encore fallait-il que le contenu soit à la hauteur du contenant.
Blackwater est donc l’histoire de la famille Caskey, propriétaires aisés d’une petite ville d’Alabama, Perdido, coincée entre deux bras de rivières dont l’une donne le titre à la saga. Il serait fastidieux et sans grand intérêt de détailler les nombreux personnages que l’auteur nous propose de suivre sur cinq générations, à partir de 1919…
Tout commence par une crue gigantesque, qui vient de ravager la petite ville, contraignant les habitants à se réfugier sur les hauteurs. Alors qu’Oscar Caskey et son domestique, Bray, explorent les environs en canot, ils découvrent une rescapée, oubliée dans une chambre d’un hôtel immergé. Comment a-t-elle Elinor Dammers a-t-elle pu survivre quatre longs jours, ainsi qu’elle le prétend, sans boire ni manger ? Cette question sans vraie réponse n’empêche pas la nouvelle venue de s’introduire dans la famille, malgré les réticences évidentes de la matriarche, Mary-Love, une femme au caractère impossible qui va se heurter à la force tranquille d’Elinor…
Une écriture simple et agréable, sans fioriture et très lisible, au service d’une histoire que la multiplicité des caractères rend passionnante.
Des personnages nuancés, crédibles et originaux ; un microcosme régenté par les femmes, où les hommes apparaissent soumis, dénués d’initiative et d’opinion, abandonnant à leurs épouses, leurs mères, leurs filles tout pouvoir de décision pour faire gentiment tapisserie ; d’étonnantes manies familiales, reproduites de générations en générations, comme celle de s’approprier les enfants des autres ou de les échanger contre faveurs ou services ; enfin, une touche de fantastique et de surnaturel qui apporte au récit une dimension poétique et étrange, sans jamais prendre le pas sur l’intrigue principale.
Vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé, même si le dernier tome m’a paru un peu au-dessous des précédents, comme si l’auteur lui-même s’était lassé de son univers et n’avait pas bien su de quelle façon terminer. Cette fin en demi-teinte, presque triste, aidera sans doute le lecteur à quitter les Caskey avec un peu moins de nostalgie et de regret, tant il avait eu le sentiment d’appartenir au clan.