Les Inexistants : Extrait 1
A quelques jours de la sortie des Inexistants, je vous propose en avant-première les premières pages…
N’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire !
Après le boulot, c’est ici que je viens.
Les fenêtres sont très hautes, c’est l’unique inconvénient. Pour observer, il te suffirait de monter sur une chaise. Moi, je n’en ai pas besoin, je n’ai qu’à me hisser sur la pointe des pieds et je peux voir tout le parking. Nous sommes plutôt grands dans la famille.
Il fait froid, ce soir. Ce serait très possible qu’il se remette à neiger, d’ailleurs le chasse-neige est passé. Elle ne craint pas le froid, je l’ai remarqué. Souvent, même quand il gèle, elle sort sous l’auvent dans son uniforme de serveuse et elle fait les cent pas, comme une pute qui attend le client.
Le paternel allait aux putes. Il disait que c’était normal et que, du moment qu’on paie, même pour un homme marié, ce n’est pas tromper. On peut se demander ce qu’en pensait sa femme. Il m’emmenait, parfois. À quinze ans, il n’était pas question de monter. Je devais attendre en bas, dans une sorte de boudoir sordide, où les filles trompaient l’ennui en buvant et en ingurgitant toutes sortes de drogues qu’elles ne rechignaient pas à partager. Il y avait une rousse, Emma, aux longs cheveux et à la vulgarité joyeuse. Elle m’aimait bien. Un jour, à force d’insistance, elle a consenti à me montrer ce qu’elle appelait « son bureau ». La chambre était petite, les draps sales et froissés, des capotes usagées traînaient sur la table de chevet. Ça sentait le sexe et le renfermé. En contrejour, dans l’encadrement de la fenêtre à persiennes, Emma parlait d’elle, souvenirs d’une enfance bizarrement normale et heureuse. La mélancolie aidant, avec une maladresse adolescente, j’ai fini par tenter de l’embrasser. J’ai récolté une gifle monumentale.
Le paternel attendait dans la voiture. Il riait tout seul, le regard brumeux et la braguette ouverte. Il m’a demandé, la voix pâteuse, si j’avais enfin baisé. Ce soir-là, je l’ai haï pour la première fois.
Il n’y a pas foule, aujourd’hui.
Il y a le froid, bien sûr, mais surtout les gens ont peur. Avec les horreurs que la radio leur assène, c’est sûrement normal. Les journalistes débitent un sacré ramassis de conneries. Ça m’amuse, de les écouter. Je zappe entre leurs flashs spéciaux et leurs interviews exclusives qui n’apportent rien, ou des contre-vérités, et la fréquence-police pour me tenir au courant de leurs avancées. Pour le moment, ça brasse beaucoup d’air, d’un côté comme de l’autre, mais il ne se passe rien de tellement concret. Tant mieux.
Je la surveille. Dès qu’elle sort de la cuisine et qu’elle apparaît dans mon champ de vision, je ne la lâche plus des yeux. J’ai apporté des jumelles que je n’utilise pas. J’ai toujours eu une très bonne vue. Pour la chasse à l’affût, le paternel disait que c’était un sacré avantage.
Évidemment, elle n’a plus la fraîcheur de ses quinze ans, mais elle reste jolie, il n’y a pas à discuter. Le petit tablier, ça a un côté excitant, ça affine la taille et ça gomme les hanches. Elle porte comme toujours son corsage à rayures qui lui comprime un peu trop la poitrine. Elle a de gros seins qui ne tombent pas, bien que la plupart du temps elle ne mette pas de soutien-gorge.
L’idée m’excite et sans même y réfléchir, je glisse la main vers mon sexe et je me caresse un moment avant de sursauter, reprenant brutalement mes esprits, au bord de l’orgasme.
Merde. Quelle salope !
Quelques secondes de plus, et j’aurais tout à fait perdu le contrôle.
En colère, je recule et je m’adosse au mur, la respiration emballée. La cigarette que je viens d’allumer pend à mes lèvres, je l’arrache et je l’écrase sur mon poignet. Brûlure fulgurante, trait de souffrance pure, jouissive. Bien sûr, l’effet ne dure pas, mais ça marche foutument mieux que leurs saletés de médicaments pour garder l’esprit clair.
Je ne la désire pas, cette salope.
Je chasse.
Pour me distraire, je repense à toi, au moment délicieux où j’ai enfoncé mon couteau dans ton nombril et où je t’ai ouvert le ventre. J’ai regardé tes tripes dégueuler sur le trottoir, et je t’ai forcée à regarder aussi, à patauger dans ton sang et ta merde qui se répandaient. J’entends encore ta voix quand tu suppliais, quand tu implorais mon pardon, juste avant de crever.
Il n’y avait rien à pardonner, mais je te jure, j’ai pris mon pied.
La première fois, c’est vrai, j’ai trouvé que tuer était une chose difficile. Mais ensuite…
Ensuite, c’est comme pour tout. On y prend goût.


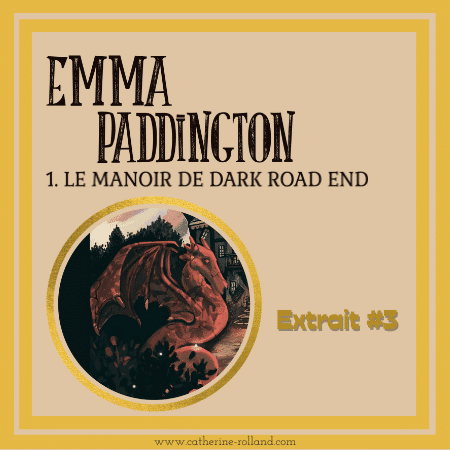





Je trouve cet extrait « cru » mais captivant. Ça donne envie de lire la suite…
Merci Catherine.
Merci beaucoup ma chère Mireille ! Je me réjouis de te faire découvrir ce roman 🙂