Une bien étrange rencontre
Un collègue médecin me raconte un jour l’histoire suivante :
Alors qu’il se trouve en vacances au bord de la mer, un estivant téméraire saute dans les vagues depuis un petit promontoire et se fracasse la tête sur le fond rocheux. Le malheureux émerge de l’eau quelques secondes plus tard, titubant, le crâne en sang. Panique sur la plage. Exclamations. Cris. Tout le monde se précipite, s’improvise secouriste et y va de son conseil avisé, au point qu’on se croirait au coeur d’un débat d’experts sur les réseaux sociaux.
« Il faut l’asseoir ».
« Non, il doit rester debout »
« Est-ce que quelqu’un a des pansements ? »
« Il faut du froid »
« Non, du chaud »
Mon collègue, anesthésiste-réanimateur de son état, s’est redressé sur sa serviette et observe la scène de loin avec un ennui vague.
Les recommandations fusent, chacune plus improbable que la précédente. Le blessé, lui, est de plus en plus pâle, de plus en plus chancelant, et saigne toujours abondamment.
« Est-ce qu’il y a un médecin sur la plage ? » s’exclame finalement le maître-nageur.
LA question
Celle que nous, les soignants, nous redoutons autant que nous l’avions espérée, quand nous étions étudiants. Comme nous rêvions, à l’époque, de nous précipiter au secours de tous les accidentés du département ! De mettre en pratique nos connaissances toutes neuves et nous couvrir de gloire ! Puis le temps a passé, on s’est assagis et on s’est aperçu que, la plupart du temps, les badauds parviennent à très bien se débrouiller jusqu’à l’arrivée des pompiers.
Encore faudrait-il, évidemment, que quelqu’un ait songé à les appeler.
Mon ami concluait son histoire en assurant avoir gardé l’anonymat aussi longtemps que possible, mobilisant toute sa puissance mentale pour suggérer, par la pensée, aux sauveteurs affolés de comprimer la plaie. Il était malheureusement meilleur médecin que télépathe, et lorsque quelqu’un avait fini par proposer de poser un garrot au cou, de guerre lasse, il s’était décidé à se manifester.
Quel rapport avec le sujet qui nous occupe, me direz-vous ?
Eh bien, comme mon collègue rattrapé par sa conscience professionnelle alors qu’il se dorait au soleil sans embêter personne, j’évite autant que possible de mélanger mes deux métiers et mes deux vies. J’y réussis plus ou moins bien, je dois le reconnaître, et je pense qu’il n’y a pas grand monde, à l’hôpital où je travaille, qui ignore que je commets des livres à intervalles relativement réguliers.
En dédicace, je suis plutôt là pour parler de littérature, et il est toujours un peu déstabilisant de voir un lecteur dévier sur son bulletin de santé ou me demander mon avis sur les dernières déclarations du ministre de la Santé.
Cependant, cette double casquette me vaut quelquefois des échanges touchants, quoique légèrement surréalistes.
Ainsi, au salon du livre de B., je participe à une table ronde diffusée en simultané dans tous les haut-parleurs, si bien que personne n’ignore plus que je suis médecin. Il faut dire que « Le cas singulier de Benjamin T. » mon cinquième roman, a occupé une bonne partie de l’entretien. Le héros, ambulancier, est atteint d’épilepsie, thématique justifiant que le journaliste fasse allusion à mon autre métier.
Revenue à ma table, je vois arriver un très petit et très vieux monsieur, en costume trois-pièces, coiffé d’un élégant chapeau, appuyé sur une canne qui accentue son air fragile et légèrement désorienté. Comme il convient face à tout potentiel lecteur, je me redresse sur ma chaise, prête à offrir mon plus beau sourire et l’argumentaire de présentation de mes romans dans la foulée.
L’élégant vieux monsieur, cependant, semble aussi peu intéressé par ma personne qu’il est possible.
Encombré par sa canne, il finit par la poser sans cérémonie en travers des piles de livres de mon voisin, qui me lance un regard à mi-chemin entre amusement et exaspération. De sa poche, il extrait un petit carnet dont il tourne les pages avec soin, sourcils froncés, peinant à se relire avec des lunettes manifestement peu adaptées à sa vue.
Il finit par trouver ce qu’il cherche, son visage s’éclaire ; il pose le carnet ouvert sur mes exemplaires du Cas singulier de Benjamin T. ; je peux voir, à l’envers, les feuillets noircis d’une écriture brouillonne et très serrée ; dans son autre poche, il trouve un stylo-plume, le dévisse, pose le capuchon ruisselant d’encre sur la couverture de mon second empilement de bouquins ; il s’y accoude pour être plus confortable, puis pousse un soupir satisfait ; enfin, il me regarde dans les yeux.
— Vous êtes Catherine Rolland ? demande-t-il avec suspicion.
J’acquiesce, un peu décontenancée.
— Vous êtes médecin ? poursuit-il, avec ce même ton réprobateur de maître d’école à l’ancienne, terrorisant ses élèves d’un infime mouvement de sourcil.
Je ne serais pas autrement surprise qu’il dégaine une règle en bois pour me taper sur les doigts si ma réponse ne lui convient pas. Mon voisin de table me jette des coups d’œil un peu alarmés. Je n’en mène pas très large.
— … Je vous ai entendue le dire ! ajoute-t-il en désignant les haut-parleurs, d’un mouvement de plume ascendant qui projette quelques gouttes d’encre sur mes livres encore épargnés jusque là.
D’un geste aussi naturel que possible, je rapatrie mes derniers exemplaires intacts hors de portée et lui adresse un sourire un peu crispé.
— En effet. Je travaille dans un service d’urgences, confirmé-je, me demandant avec anxiété où cette conversation va nous mener.
Il opine, satisfait, puis il dit, en me regardant avec intensité, stylo-plume au-dessus du carnet, prêt à noter :
— Que pouvez-vous me dire sur l’épilepsie ?
La question me renvoie aussitôt à l’époque où je passais mes oraux de médecine, et je ressens une vague de stress à peu près similaire à celle que j’éprouvais au moment de répondre à l’examinateur. S’il n’y avait pas, en bruit de fond, le fou-rire mal étouffé de mon voisin de table, je pourrais presque me croire revenue au temps de mes études. Si on m’avait dit, alors, que la qualité de mes connaissances en neurologie serait un jour contrôlée par un improbable centenaire, dans un salon littéraire du nord de la France, j’imagine que je ne l’aurais pas cru.
Peinant à comprendre ce qu’il attend de moi, je m’exécute et tente de résumer, dans les grandes lignes, ce qu’il convient de savoir au sujet de cette maladie compliquée, et les progrès qu’a fait la médecine depuis l’époque où on se contentait d’exorciser les malades ou de les jeter au bûcher.
Le vieux monsieur hoche la tête à intervalles réguliers et prend des notes dans un silence absolu.
Aucune émotion ne filtre sur son visage, il garde une expression concentrée et reporte avec fièvre chacun de mes mots sur son petit carnet. C’est effrayant et, je l’avoue, vaguement flatteur aussi, bien que le sens de ce que nous sommes tous les deux en train de faire m’échappe totalement.
Embarquée dans mes explications, je continue mécaniquement à causer électroencéphalogramme, crise partielle ou généralisée, état de mal et efficacité de la Dépakine tandis qu’à côté, mes voisins enchaînent les ventes et signent à tour de bras. Il a fallu, évidemment, que mon étonnant interlocuteur choisisse pour m’aborder le seul moment d’affluence pendant cette journée particulièrement calme.
Avec un léger désarroi, je vois une petite foule passer dans son dos, regarder par-dessus son épaule pour déchiffrer le titre de mes livres, m’adresser, parfois, un sourire contrit, puis s’en aller plus loin.
Je finis par me taire, ayant épuisé l’ensemble de mes connaissances sur la question. Il reste immobile pendant quelques secondes, puis croise mon regard interrogateur. Il hoche la tête, marmonne pour lui-même quelque chose que je ne comprends pas, referme son carnet, recapuchonne son stylo.
Mon voisin a pris la liberté de poser la canne contre le bord de la table pour libérer l’accès à ses livres (qu’un de nous deux, au moins, réussisse à faire ce pour quoi il était là initialement). Le vieux monsieur la récupère en le foudroyant du regard, puis rajuste son chapeau.
Je demande, incertaine :
— C’était ce que vous vouliez savoir ?
Il était déjà en train de s’en aller, je crois. Ma question semble lui rappeler que j’existe, il se retourne à peine pour me jeter un regard un peu absent.
— Oui, oui, murmure-t-il dans sa barbe, le ton ailleurs. C’était très bien.



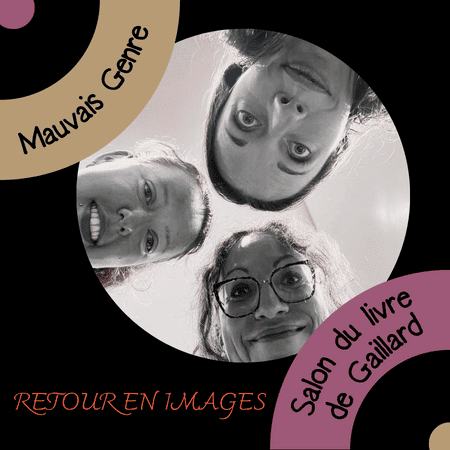
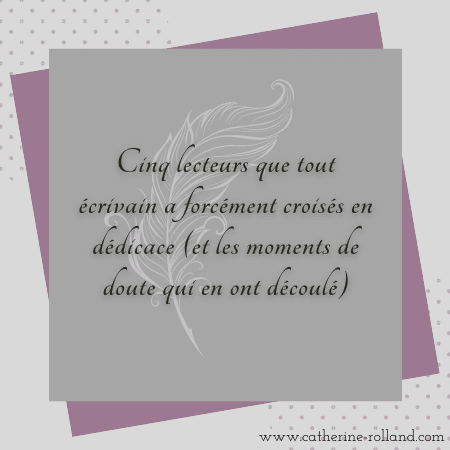



Incroyable et drôle à la fois. Tu es une véritable conteuse.
Oh, merci Geneviève pour ce très élogieux commentaire. Je suis touchée.